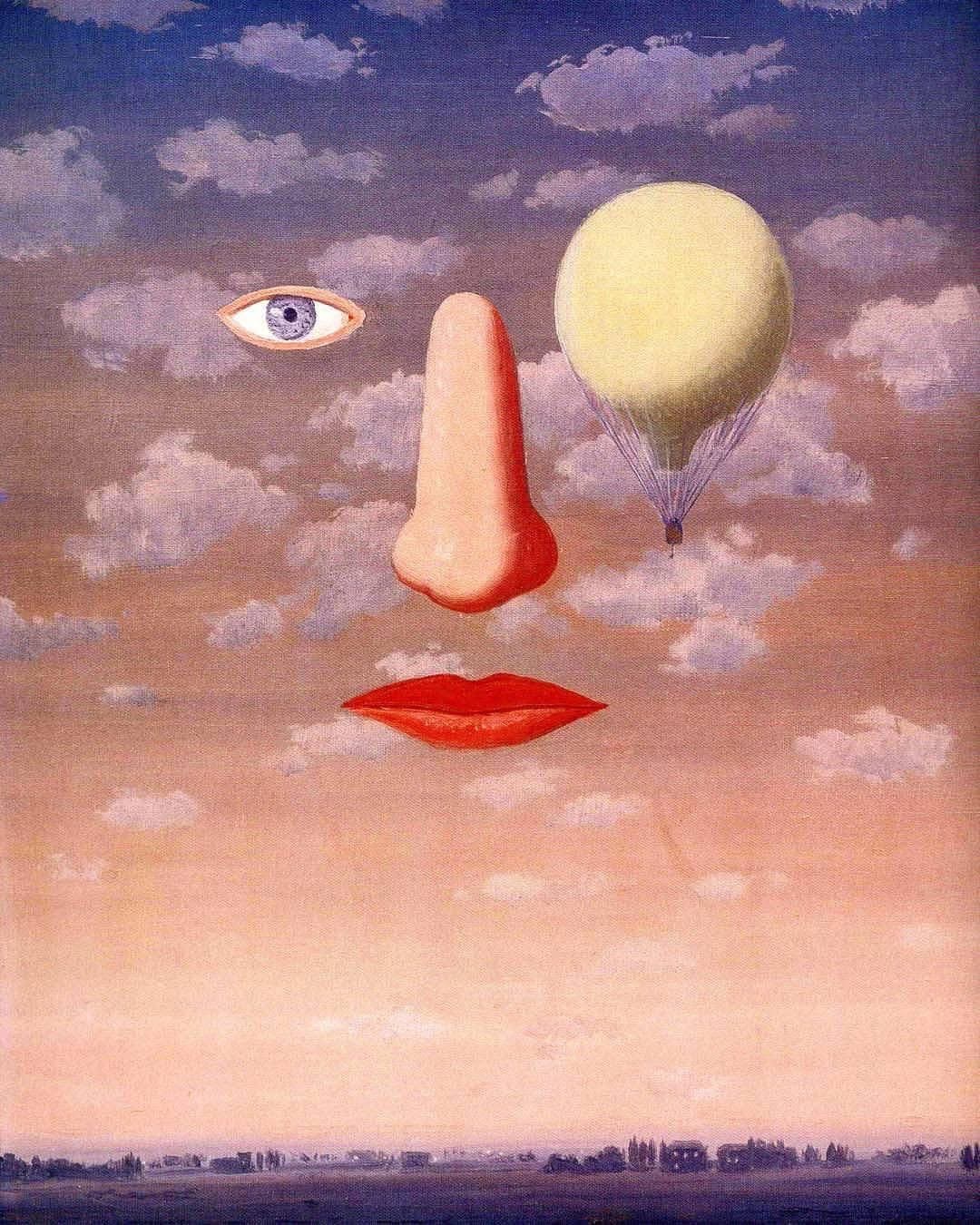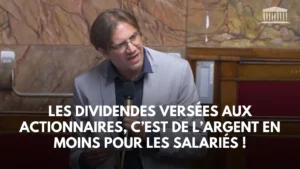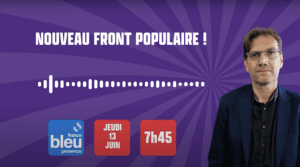Le texte de Samuel Hayat qu’il a rédigé après le complément d’enquête a beaucoup circulé. C’est très positif, car cela permet de débattre du fond à un moment où l’acharnement médiatique contre LFI tend plutôt à obscurcir le débat. Mais j’ai des désaccords avec certaines de ses conclusions, j’y reviens dans cette note de blog.
Pourquoi un tel acharnement médiatique ?
Un mot sur cet acharnement contre LFI, qui s’est amplifié avec la sortie du livre « la Meute ». Je suis déjà revenu dessus cette semaine dans les médias, sur BFM, RTL et France Bleu. Quel est le projet politique de cet acharnement ? Est-ce d’affaiblir la gauche radicale et LFI ? Oui bien sûr, mais en réalité les attaques répétées contre Jean Luc Mélenchon solidifient son socle. La droite le sait bien. L’objectif est ailleurs : c’est de durablement rendre LFI « infréquentable » et donc de diviser la gauche en deux. Ce qui terrifie les classes dirigeantes et les macronistes, c’est que le Nouveau Front Populaire – c’est-à-dire le rassemblement de la gauche et des écologistes sur une ligne de rupture – survive. C’est pour cette raison, que ne devons pas crier avec la meute. Il faut garder notre cap : l’unité sur le programme du NFP. Quand les néofascistes sont aux portes du pouvoir, l’unité dans la rue et dans les urnes est une condition nécessaire (mais pas suffisante) pour éviter le pire.
Néanmoins, le fonctionnement de LFI et les succès de Jean Luc Mélenchon doivent interroger la gauche. Il n’est pas possible de rester silencieux. J’avais déjà examiné le fonctionnement de LFI dans certaines notes de blogs de juin 2017 et décembre 2022 et dans la quatrième partie de mon livre. Contretemps a d’ailleurs publié certains passages concernant la démocratie.
Examinons donc quelques présupposés et conclusions de Samuel Hayat avec lesquels je suis en désaccord.
De l’efficacité
Ce qui m’a le plus gêné, dans le texte de Samuel Hayat est qu’il ne s’intéresse à l’efficacité politique, presque que par le prisme des résultats aux élections présidentielles. L’efficacité politique est évidemment plus large. C’est d’abord, la place militante dans la société qui donne de la capacité d’agir. C’est les liens de ces militants avec le mouvement social et associatif, ce qui permet de faire coaguler un vrai front social et politique capable de victoires sociales. Ensuite, c’est les victoires électorales aux élections locales qui permettent d’occuper des positions dans les exécutifs locaux ou au moins dans les oppositions. Enfin, l’efficacité d’une structure se mesure sur la durée. La CGT a cette année 130 ans.
Quelle est la réelle efficacité de LFI, sur tous ces aspects ? LFI a été créé pour prendre le pouvoir central lors d’une élection présidentielle. A bien des égards, LFI a remplacé pour prendre le pouvoir, la grève générale insurrectionnelle du mouvement anarcho-syndicaliste, par l’élection présidentielle. Samuel Hayat a raison, cela détermine complètement le fonctionnement de LFI et sa stratégie. Mais sur le reste du champ électoral LFI a plutôt échoué, notamment aux élections locales. Les municipales de 2020 comme les régionales et départementales de 2021 ont été des fiascos pour LFI. Les barons socialistes ont résisté malgré l’effondrement socialiste de 2017. Plus récemment, l’échec de Louis Boyard est aussi significatif.
Sur le lien entre mouvement social et force politique, le bilan est contrasté. J’avais examiné depuis longtemps les faiblesses de la stratégie de Jean Luc Mélenchon concernant le lien entre les partis et syndicats. A l’époque, nous en avions discuté avec Jean Luc et l’échange avait d’ailleurs été plutôt riche. LFI a été capable de mobiliser la population dans la rue. C’est la seule force politique de gauche qui a cette capacité. Par contre, elle est faiblement liée au mouvement social organisé. Et LFI oscille selon les moments entre un suivisme des organisations syndicales et un véritable sectarisme vis-à-vis d’elles. Il y a un refus de comprendre qu’il existe des rôles différents entre un parti politique et un syndicat. Jean Luc Mélenchon avait la prétention avec LFI de construire le mouvement global qui remplace toutes structures existantes, syndicats et associations qu’il estimait moribondes. Le mouvement des retraites a démontré que même affaiblis les syndicats jouaient encore un rôle central dans la lutte des classes.
Paradoxalement, c’est dans le champ de la bataille idéologique que LFI a été la plus utile et la plus efficace. J’y reviendrai plus largement ensuite. Mais examinons les conditions des succès à la présidentielle.
Qu’est ce qui détermine l’efficacité ?
Le principal désaccord que j’ai avec le texte de Samuel Hayat est qu’il part du présupposé implicite que les succès à une élection sont dus au fonctionnement de l’organisation. Je ne le crois pas.
Rappelons d’abord que si Jean Luc Mélenchon a battu les autres candidats de gauche, il n’a pas été ni en 2017, ni en 2022 au second tour. Donc, si ses campagnes ont été des succès indéniables pour la gauche radicale, elles ont été des échecs pour la gauche dans son ensemble et des échecs pour la lutte des classes. Mais disons-le tout de suite, cet échec global n’est pas de la responsabilité de Jean Luc Mélenchon, mais bien de François Hollande et plus largement du parti socialiste, qui a accompagné le virage néolibéral depuis 1983. Je referme la parenthèse.
Ce qui fait le succès ou non d’une candidature est très largement déterminée par le contexte politique. Si Jean Luc Mélenchon fait de bons scores en 2017 et 2022 c’est d’abord et avant tout, que le programme politique qu’il porte répond à une attente. Partout dans le monde, les gauches sociales-démocrates se sont effondrées, car elles accompagnaient un système capitaliste de plus en plus prédateur, secoué par des crises successives. Si en Amérique Latine, ce sont les versions – populiste de gauche- qui l’ont emporté, ce n’est pas le cas partout. Le seul pays où la gauche radicale arrive au pouvoir c’est la Grèce, avec Syriza qui correspond à une coalition de gauche traditionnelle. Certes Syriza fut un échec, mais Chavez aussi au final…Les progressions de la gauche radicale en Europe sont le fait de formations ou de coalitions aux contours et histoires et fonctionnements très variés : Syriza en Grèce[1], le PTB en Belgique[2], Podemos en Espagne[3], Die Linke en Allemagne[4], le Bloco au Portugal[5]. D’ailleurs, en Allemagne la « résurrection » de Die Linke, se fait au détriment de Sahra Wagenknecht, qui a fondé un mouvement autour de sa personne sur une ligne populiste anti -immigré.
Enfin, en 2017 et 2022, Jean Luc Mélenchon a largement bénéficié d’un vote utile. Il a un socle a 10-12% déjà atteint en 2012. Il finit à 22% en 2022, car beaucoup d’électeurs ont utilisé le bulletin Jean Luc Mélenchon pour empêcher Marine Le Pen d’être au second tour. A mon avis, la dynamique du vote utile sera différente en 2027, car l’enjeu ne sera pas : qui pour empêcher le RN d’être au second tour, mais qui pour battre le RN au deuxième tour ? Et là le plafond de verre de Jean Luc Mélenchon est un verrou insoluble.
Du mouvement gazeux et du charisme
Une vraie nouveauté de LFI est son fonctionnement gazeux qui s’apparente à une startup néolibérale, parfaitement adapté à l’ubérisation de la société[6]. Mais ce fonctionnement n’est pas seulement une réponse à la logique présidentielle, contrairement à ce qu’explique Samuel Hayat. D’ailleurs, il a été inventé en Espagne par Podemos en 2014. C’est ensuite qu’il est importé en France en 2016. Or en Espagne c’est un régime parlementaire. Hélas, l’efficacité de ce type de modèle a des origines bien plus profondes.
Le fonctionnement gazeux avec une plateforme, un programme et des militants consommateurs est je pense une réponse fonctionnelle à la progression de l’idéologie néolibérale dans la société et à gauche. Nous sommes passés de la construction d’organisations sur le long terme à la consommation politique. De plus en plus de militants ne sont pas intéressés à participer à l’élaboration collective. Si le programme leur va, ils le soutiennent, s’il ne leur va pas, ils quittent la plateforme. Ils agissent avec la politique comme avec Netflix. Je me suis toujours battu dans LFI pour plus de démocratie interne, ce qui passe par avoir des adhérents qui cotisent et votent sur les orientations. Mais je dois bien concéder que beaucoup de militants dans LFI s’en foutent littéralement. Ce fonctionnement gazeux a-démocratique répond à une demande et cela a une efficacité réelle, puisque LFI est la force politique qui dispose le plus de militants, notamment de jeunes. En Marche a d’ailleurs copié ce fonctionnement. C’est un enjeu central. Est-il possible au XXIème siècle de construire des partis de masse qui fonctionne démocratiquement ? Existe-t-il une base sociale qui souhaite ça ? Je continuerai inlassablement de me battre pour ça. Mais est ce que le démantèlement du monde ouvrier par le stade néolibéral du Capital n’a pas durablement rendu obsolète le modèle des partis du XXème siècle ? C’est un vrai sujet.
Du coup, si les forces politiques se construisent à partir de produits politiques médiatiques par en haut, la question du charisme devient encore plus importante qu’avant. Samuel Hayat a raison de lancer le débat sur ce sujet. Le charisme a toujours joué en politique. Jean Luc Mélenchon est probablement le leader politique le plus charismatique. Tout le monde le concède, en campagne il est redoutable.
Samuel Hayat explique que le charisme émerge du collectif. Il a raison, mais il lie le fonctionnement autoritaire de l’organisation et le charisme du leader. Je suis plus circonspect. Le charisme de Jean Luc Mélenchon procède d’abord de ses succès en tant que dirigeant. Il a pris les bonnes décisions depuis 2009, j’y reviendrai par la suite. C’est de cette façon qu’un dirigeant politique acquiert le respect. Après le mécanisme décrit par Samuel Hayat fonctionne aussi. Quelqu’un qui domine un groupe social, augmente son pouvoir au-delà du groupe initial. Il y a des mécaniques de pouvoir qu’il faut analyser quasi chimiquement au sein des groupes. Leur efficacité doit beaucoup aux normes dominantes dans la société patriarcale.
Mais quand on a des fonctionnements autoritaires, il y a un moment où le leader charismatique se coupe de la réalité, car l’autoritarisme produit du mensonge dans l’entourage du leader. Cela a abouti au fiasco de la chloroquine dans le clan très autoritaire de Didier Raoult… Ce mensonge organisé si bien décrit par Orwell a conduit le système stalinien à la faillite. On peut donc espérer que le charisme puisse se construire sur d’autres bases que sur l’autoritarisme.
Programme et stratégie de rassemblement
Pour conclure, selon moi le relatif succès de LFI doit beaucoup plus à sa stratégie politique et à son programme. La crise du capitalisme, les renoncements de la social-démocratie et la chute du monde soviétique ont ouvert la voie de la recomposition à gauche. En France, celle-ci a d’abord débuté dans la rue avec la grande grève de 1995, puis dans le mouvement altermondialiste. Un programme antilibéral s’est construit avec ATTAC et a gagné en 2005[7]. A partir de là, il fallait unifier la gauche antilibérale dès 2005 pour gagner à gauche l’hégémonie sur le PS[8]. C’est ce que la LCR et le NPA ont échoué à faire à l’époque, car la direction était trop gauchiste. Le génie politique de Jean Luc Mélenchon est d’avoir compris cela avec d’autres et d’avoir rompu avec le PS en 2009 pour fonder le Front de Gauche. Il a ainsi, avec l’aide du PCF et d’une partie de l’extrême gauche (ceux qui ont quitté le NPA à l’époque) réussi à unifier ce camp en 2012.
L’autre grande réussite de LFI est d’avoir poursuivi le travail programmatique initié avec le PCF avec l’humain d’abord. Le plus beau leg de Jean Luc Mélenchon, ce n’est peut-être pas les scores en 2017 et 2022, mais l’avenir en commun et la NUPES. L’union de gauche et des écologistes a pu se faire sur une base de rupture et l’emporter aux législatives de 2024 avec le NFP. C’est cette histoire qu’il faut poursuivre. Nous essayons d’y contribuer avec l’APRES, une force radicale comme LFI, mais unitaire et démocratique.
Mais aujourd’hui cette histoire ne pourra pas s’écrire sans les insoumis. Il est donc utile de débattre du fonctionnement de LFI et d’espérer que LFI comme le PS fassent le choix de l’union dans les mois et années qui viennent. Sinon les fascistes feront en sorte que nous ayons plus le loisir de débattre de tous ces sujets passionnants.
PS : Le texte était déjà long je ne suis pas revenu sur le soi-disant léninisme de Jean Luc Mélenchon. Évidemment, plus la lutte des classes devient aigue, plus la question de l’homogénéité de notre camp devient un sujet stratégique. Mais mettre l’absence de démocratie sur le dos du Bolchévisme est une erreur, je conclurais par une citation de Trotsky de 1931 tirée de ma précédente note de blog :
« Mais toute l’histoire du bolchevisme est l’histoire de luttes intérieures intenses, dans lesquelles le parti acquérait ses opinions et forgeait ses méthodes. Les chroniques de l’année 1917, la plus importante dans l’histoire du parti, sont pleines de luttes intérieures intenses, comme l’est également la période des cinq premières années qui ont suivi la prise du pouvoir : et cela, sans scission, sans une seule exclusion importante pour des motifs politiques. (…). D’où vient donc ce « monolithisme » [du KPD] effrayant d’aujourd’hui, cette unanimité funeste qui transforme chaque tournant des chefs malencontreux en une « Aucune discussion ! »
[1] 26% aux législatives en 2012 et 36% en 2015
[2] 14% en Wallonie en 2019 et 18% à Bruxelles en 2024
[3] 20% aux législatives en 2015
[4] 12% aux législatives en 2009 et 15,6% en 2016 à Berlin
[5] 10% aux européennes de 2009 et aux législatives de 2015.
[6] Pour une analyse détaille de ce fonctionnement : voir ma note de blog de 2022 : https://blogs.mediapart.fr/hendrik-davi/blog/111222/de-la-refondation-de-la-france-insoumise
[7] Davi, H, 2019. Les défis des gauches en France. Un article de la revue Nouveaux Cahiers du socialisme Numéro 21, Hiver 2019, p. 44–48. Penser la Grande Transition. https://id.erudit.org/iderudit/90573ac
[8] Davi, H, 2008. Questions marxistes posées par l’unité antilibérale. Socialisme International N° 19/20